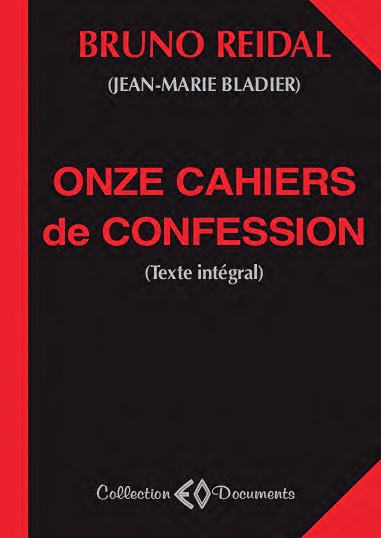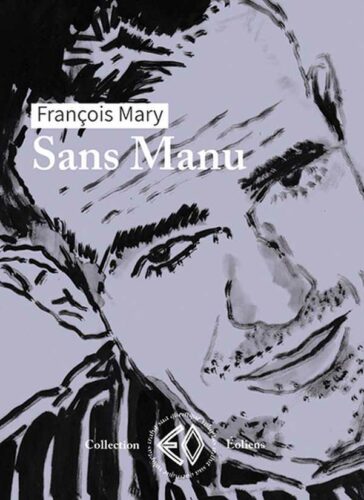
Une voix, ici, s’élève, qui nous parle et qu’on entend avant de la lire. Une voix douce, calme, posée, presque lente, pour décrire avec d’autant plus de force un malheur. Elle dit l’épreuve simplement, sans effet, avec une grande sensibilité. Mais devant la brutalité de son irruption, la violence de l’arrachement, les mots viennent à manquer. Car ce dont il s’agit n’est autre qu’une histoire d’amour brisée, l’histoire d’amour exigeante, sauvage, non conventionnelle entre deux hommes dont l’un n’a pas trente ans et l’autre soixante-dix. Et qui s’est fracassée sur la mort soudaine du plus jeune.
La voix est donc celle du plus âgé, de celui qui survit. Elle va raconter cette douleur, cette perte. A travers tous les détails significatifs de la vie quotidienne, tous les moments importants de ce couple atypique, découpés en de très brefs chapitres, au nombre de soixante-quatre exactement, qui sont comme autant de vignettes sauvegardées de l’oubli, elle va, à travers ces évocations parfois déchirantes, explorer ce manque. Elle va parler de Manu.
Et elle commence par là où tout s’est arrêté, un 27 décembre à 1 heure du matin. La mort de Manu, inopinée, silencieuse, intervenue dans son sommeil, chez son ami d’enfance. C’est le point de départ choisi pour raconter cette histoire, et qui en est aussi le point d’achèvement. Avec tout ce qui s’ensuit, les obsèques, l’enterrement, et aussi le rappel des quelques jours qui ont précédé, le dernier Noël. S’enclenche alors la mécanique des souvenirs, leur défilé inexorable. Et la douleur supplémentaire d’apprendre sur cette mort, après qu’elle a effectivement frappé, qu’elle était quasiment prévisible. Parce que Manu était en très mauvaise santé, que son médecin s’en était alarmé, alors que lui-même n’en avait dit mot à personne et n’avait rien changé à ses habitudes, bien au contraire. Le savoir fait prendre tout à coup à cette mort une autre signification.
Car tout laisse ainsi à penser que cette mort, Manu, consciemment ou non, l’a désirée, qu’il l’a attendue sans rien faire pour l’éviter ou à tout le moins la retarder. Une scène en particulier revient à la mémoire, celle où, en proie à une angoisse soudaine, il s’exclame devant son compagnon qu’il « voudrait mourir ». Quel est cet attrait pour la mort que cela révèle, et que son refus de tenir compte des avertissements du médecin, sa volonté féroce de continuer à vivre comme si de rien n’était accélèrent, si ce n’est un penchant suicidaire ?
Que cette découverte après coup afflige son compagnon ne l’empêche pas de vouloir exposer ce qu’ont représenté pour lui les moments passés en compagnie de Manu et leur redonner toute leur vitalité, toute leur lumière. Sans rien cacher des heurts de la vie, des incompréhensions, des ruptures de ton et de comportement d’un caractère parfois difficile, auxquels succèdent des accalmies et des instants de vrai bonheur. Et même devant les accès de colère et de violence de cet homme jeune, souvent impulsif, il reste d’une grande attention, d’une grande tendresse, d’une générosité qui est celle d’un amour authentique, désintéressé, qui laisse toute la place à l’autre sans rien prendre de force mais à l’inverse accueillant comme une richesse les moindres signes de complicité et d’assentiment.
Au fond cette relation, pour lui, est un allègement. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, d’abord un allègement des corps. La passion amoureuse, l’étreinte charnelle, au lieu d’être le lieu d’une pure ivresse des sens, ou justement parce qu’elle l’est à plein, lui procure une sensation incomparable de légèreté. La seule occasion peut-être d’échapper à la pesanteur des corps. Celui de Manu, « un peu massif », le sien, moins solide mais qui pèse lui aussi en temps ordinaire, et plus encore après la fin brutale de leur amour. C’est le poids retrouvé du corps après la disparition de cette fusion physique seule capable de la lui faire oublier, et dont il ne reste que le souvenir brûlant, à « se perdre dans la nuit de son corps. Dans son aveuglante lumière », qui devient intolérable et le transforme en simple « viande, à l’étal ».
Finalement, de toutes ces images, de toutes ces scènes que la présence de Manu illumine, de toute cette intensité de sensations découle un sentiment douloureux, torturant, qui fait dire au compagnon devenu le témoin de ce passé partagé, avec René Crevel, que « la mémoire n’est pas une alliée, mais bien une ennemie ».
Loin de l’image positive que peut avoir le souvenir, associé à un état agréable ou tout au moins réconfortant, apparaît ici, en effet, un aspect plus négatif, quand il est, comme au sujet de Manu, blessure à vif, remémoration sans fin d’une même souffrance, d’un même chagrin que rien ne peut venir apaiser. Se souvenir alors, ce n’est que répéter la douleur, sans répit.
Ces pans de mémoire, que l’on parcourt délicatement, un à un, comme les pétales d’un bouquet, reviennent à l’esprit et font mal. Ils redoublent la peine éprouvée en ce qu’ils la réactivent à chaque fois par le goût des jours heureux qu’ils distillent en même temps qu’ils en confirment la fin irrémédiable. Avec eux le plaisir et la souffrance vont de pair. Il y a là comme un dédoublement du malheur. Car en les revivant de la sorte, sachant par avance ce qu’il va advenir, que ce bonheur est condamné, on comprend tout, mais trop tard : « Je me dis, aujourd’hui, qu’il était au bord des larmes ». Ou encore, « ce baiser était le dernier. Je l’ignorais, je l’ignorais encore ».
Ainsi pourrait s’achever l’énumération des souvenirs, entre l’émotion retenue et l’abattement. Mais ce n’est pas le cas. Le désespoir, l’anéantissement ressentis par son compagnon devant la mort de Manu n’emporteront pas tout car il y a chez lui plus fort, plus haut que l’obscurcissement total. A la réalité impitoyable d’une vie sans Manu désormais, « nulle autre présence ne comblera ce vide », répondent la force de l’esprit, le pouvoir de l’art qui lui font dire que « tu ne m’as, pourtant, pas totalement quitté ».
S’ouvre alors, sur les quatre dernières pages du livre, en italique comme la page de préambule pour en marquer la particularité, un moment unique, peut-être le plus beau du livre. Manu au-delà de la mort. Une série d’images, qu’on dirait nimbées d’une lumière surnaturelle, où Manu revient partager ce bonheur qui a tant compté ici-bas et qu’il magnifie, qu’il exhausse par sa présence vibrante, solaire, insérée dans la nature qu’il a aimée, le paysage de montagne familier, « au cœur de ce qui nous tient debout ». Des scènes toute simples mais qui montrent que « chaque instant de vie qui nous est donné doit être vécu avec intensité ». Plus rien pour peser ou meurtrir, pour mettre à vif, mais au contraire l’accord revenu, le grand accord revivifiant qui lie à jamais les êtres et le monde jusqu’à les confondre. Et la voix de Manu de s’exclamer à son compagnon inquiet : « Mais tu vois bien que je suis là ! ».
Luc-André Sagne
François Mary est l’auteur de plusieurs récits et, seul ou en collectif, de nombreux livres d’artiste où se mêlent prose et poésie. Il a en outre réalisé quelques dossiers consacrés à des poètes. Il est principalement publié aux éditions Plein Chant et ErosOnyx.