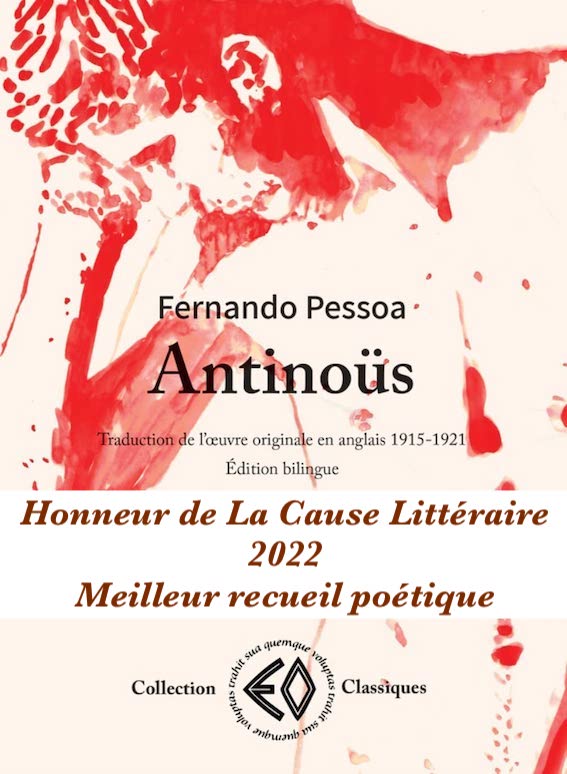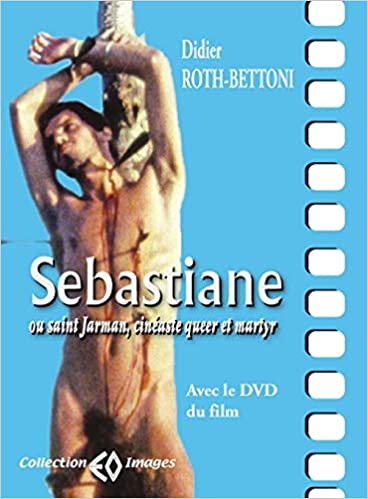Hommage à Barbara
de Stéphane Loisy et Baptiste Vignol (Gründ, 2017)
Il faut les ouvrir, les savourer lentement, les garder longtemps en bouche pour les laisser agir, des livres comme celui-là. Avec l’apparence de la chronologie, ça vous a un feuilletage qui enlève toute sécheresse rectiligne. Ça pèse un lingot, comme les albums cadeaux des Noëls d’antan, ça crache du rose en couverture, du rose qui semble détoner pour une Barbara qu’on voit plutôt en rouge et noir, en mauve et noir, avec une photo naturelle et inédite de l’artiste en herbe, loin des portraits sophistiqués qu’on aime mais qu’on a déjà vus, ça vous colle au fil des pages un amour neuf, approfondi, de Barbara et ça le fait scrupuleusement, délicatement, passionnément.
Scrupuleusement
Il a raison, Bernard Serf, neveu de la chanteuse, d’écrire en avant-propos : « C’est clair, intelligent, bien documenté, parfois irrévérencieux, jamais flagorneur, toujours avisé ». Il sait qu’un vrai portrait amoureux n’est jamais un portrait flatté, jamais un embaumement thuriféraire ! Faut que ça vive, un livre de souvenirs et d’hommages, que ça ne sente pas le rance du déjà lu ! Pas de copier-coller d’un article du Web qui se voudrait exhaustif et qui se révèle une accumulation indigeste semée d’oublis. Le livre se veut une nouvelle approche de Barbara. Stéphane Loisy, de son côté, prend le temps de signer çà et là des esquisses d’artistes qui ont beaucoup compté pour la chanteuse et que le Web néglige : « Notre époque est merveilleuse puisque Internet fait office de mémoire collective normée et imposée. Elle recense un grand nombre d’informations en tout genre sur tout et n’importe quoi. Elle omet souvent, par contre, de parler des êtres humains et d’établir une cohérence pour des personnages libres et géniaux ». C’est ainsi qu’il convoque dans ce livre la mémoire de camarades magnifiques et rarement mentionnés, dans la vie de Barbara, comme Remo Forlani, Jean-Jacques Debout, William Sheller, Étienne Roda-Gil et Jeanne Moreau. Il n’oublie pas non plus la carrière cinématographique de la chanteuse, avec deux films trop injustement effacés de sa carrière, Frantz tourné en 1971 par l’ami Jacques Brel et L’oiseau rare en 1973 par l’ami Jean-Claude Brialy. Quant à Gérard Depardieu, il a droit à un éclairage des plus subtils. Le livre ici chroniqué paraît vingt ans après la mort de Barbara. Or, cette année-là, en 2017, Depardieu, devenu ogre sulfureux, mis à l’écart par ses débordements de poids, de gueule et de positions politiques ahurissantes chez le libertaire qu’il fut, Depardieu dit, susurre, fredonne, chante Barbara, piano-voix, en studio et dans le rouge et le noir des Bouffes du Nord. Serait-il interdit d’y voir la complicité retrouvée de Lily Passion, trente ans après, comme une « virilité domptée », comme une bulle de purification ?
Pour Baptiste Vignol, la démarche est aussi scrupuleuse. Commentaires personnels, citations de la chanteuse et de toutes les plumes qui ont déjà esquissé son portrait avant 2017, sont inextricablement réunis, avec un parti pris de notes aériennes en bas de page, à peine visibles, comme si le livre ne trouvait sa singularité qu’en s’étant discrètement nourri de ces sources multiples. Un livre érudit donc mais novateur aussi, riche de photos et d’éléments qu’un fan qui se croyait pourtant peu profane voit et lit ici pour la première fois. Pour le plaisir de la lecture, nous serons, dans cet article, moins méticuleux que les auteurs de citer toutes les sources. Le plaisir a besoin de se libérer de certaines chaînes. Que les auteurs nous le pardonnent !
Il sait, Baptiste Vignol, que les vrais amoureux aiment que leurs stars ne soient pas des déesses ou des dieux. Pas de portrait d’amour sans irrévérence, comme l’annonçait Bernard Serf. Pas d’amoureux, même aveugle, qui ne sache que l’autre a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. On apprend, par exemple, que travailler pour Barbara, après le succès enfin là avec le récital de Bobino en 1967, n’est pas une sinécure. Autoritaire, coléreuse, imprévisible, elle usait ses collaborateurs. Se mettre à son service, c’était renoncer à sa vie privée. Françoise Lo et Marie Chaix, ses secrétaires, n’ont pu tenir longtemps à ce régime dont l’envers est la quête de perfection dans chaque détail de ses spectacles : orchestrations, décors, éclairages, costumes, tout est une cérémonie où la chanteuse s’avance parée et mise en lumière comme un toréador ! Roland Romanelli, un de ses accordéonistes les plus célèbres, remercié alors qu’il donnait son avis sur la préparation de Lily Passion, la dit aussi généreuse que cruelle.
Autre paradoxe qui constitue Barbara, son rapport avec l’argent. Son enfance et sa jeunesse ont connu les privations et le pain sec de la vie d’artiste. Avec le succès dans les années soixante, ce fut la soif insatiable du luxe et des élégances jusqu’à l’ivresse des parfums de Guerlain, le Marienbad aristo de la plaisance, la munificence des mendiantes devenus princesses, contraintes d’engager un agent-comptable pour payer leurs impôts et faire que l’or ne se fonde dans leur mains comme dans un creuset. Alors qu’elle cherche un metteur en scène pour le spectacle Madame en 1969, elle rencontre Roger Blin et ne donne pas suite parce qu’il portait ce jour-là des tennis. Or, la même Barbara vibre à toutes les détresses du monde. Elle écrit en 1986 une chanson Les enfants de novembre pour Malik Oussekine, tombé à 22 ans sous les coups des forces de l’ordre du ministre Pasqua. Elle est capable d’imposer des billets au prix très abordable pour son spectacle de Pantin en 1981, d’aller gratuitement chanter pour des prisonniers et des malades du sida qui meurent seuls dans les hôpitaux. À la mort de François Mitterrand dont elle a soutenu la candidature en 1981 et 1988 et qui l’a décorée de la légion d’honneur en 1988, elle déplore que le socialisme au pouvoir en soit venu à vivre enfermé dans un autre monde et coupé de la réalité des gens : « Le pouvoir rend fou ». Sans être descendue dans la rue, Barbara s’est toujours vécue, dans son quotidien et dans nombre de ses chansons, comme une femme de combat, et ce combat, de son vivant, s’est appelé de Gauche.
Parmi les paradoxes, il en est un, secret et tout aussi éloquent, scrupuleusement évoqué : l’amour du vagabondage de sa vie de saltimbanque et le besoin de trouver un nid pour s’y ressourcer et y mourir un jour. À 43 ans, la petite fille des Batignolles achète la maison de Précy-sur-Marne, à 37 kilomètres de Paris. Elle y aménage une grange qui devient « grange aux loups » avec salle de répétition, piano, scène et sono. La bourlingueuse de théâtre en théâtre veut aussi se poser pour trouver calme et volupté dans une maison de pierre et son jardin. Elle s’épuise en se donnant à son public sur scène et a besoin de cures de sommeil pour récupérer mais au bout d’une semaine cette retraite devient prison et il lui faut renouer avec la vie. Elle a avec Précy la même relation ambiguë : l’ermitage permet de se ressourcer mais c’est aussi le lieu où la guette la solitude, avec cette alternance de mal et de joie à vivre qui fait le clair-obscur lancinant et magnifique de Barbara. Paradoxe insoluble et fascinant : être une « amie Pierrot noire », selon la trouvaille d’Hélène Hazera et une voyageuse d’Éros.
Délicatement
Comment évoquer les gouffres avec assez de délicatesse pour que les lecteurs et lectrices sentent que rien n’a été tabou dans ce livre à la fois biographie, radioscopie et déclaration d’amour ? Tout naturellement. Avec les faits nus. Monique Serf naît à Paris en 1930 dans une famille juive qui peine à joindre les deux bouts. Sa famille doit se déplacer pour mieux vivre, aller de Paris à Marseille et de Marseille à Roanne. La guerre sépare parents et enfant. Tante Jeanne de Poitiers tente de faire passer les enfants en zone libre mais le train est mitraillé par la Luftwaffe. De cela, Barbara un jour osera parler à un accordeur de piano dans la région de Châtillon-sur-Indre où la scène s’est déroulée : « La petite fille qui était dans le wagon et qui n’a pas été tuée, c’est moi ». Quand les enfants pourront rejoindre leurs parents à Tarbes, de la nuit s’ajoute à la nuit et, délicatement, l’auteur laisse la plume à Barbara elle-même qui écrit dans son livre Il était un piano noir… paru un an après sa mort : « J’ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait. Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l’horreur… »
Quant au besoin du pardon, au père comme aux nazis, c’est dans les brumes de ses chansons qu’il se chuchotera et comprenne qui voudra : en lisant ce livre, on fait mieux le lien entre Nantes et Göttingen. Le vrai champ de bataille où l’on peut triompher chez Barbara, c’est la chanson. « Chanter, dit-elle, c’est mon remède et mon poison, ce besoin de s’exhiber, c’est mon mal et ma guérison. » Tout désir lui devient compréhensible, l’inceste dans Si la photo est bonne, ou le suicide qui devient un leitmotiv fréquentable et dont on peut sourire, comme dans À mourir pour mourir. Chanter fait sortir de la mort déjà vécue pendant l’enfance. Barbara aura toujours avec l’enfance cette double relation de tendresse et de mort. À 34 ans, elle déclare : « Je suis déjà morte depuis longtemps. J’ai perdu la vie autrefois ». Mais l’enfance, c’est aussi la grand-mère Varvara, née près d’Odessa et réfugiée à Paris, conteuse d’histoires de steppes et de loups, venant d’un monde de cirque, de danseurs en habit rouge, de joueurs de balalaïka… Comment alors ne pas s’appeler Barbara ?
Comment rester étranger à sa relation éternellement double avec les hommes, avec les amours et la fidélité ? Dès le début du livre, on entre dans le mystère inépuisable de Barbara, évoquant, dans son autobiographie, l’amour comme «… une sacrée volonté d’atteindre le plaisir dans les bras d’un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après… ». Baptiste Vignol laisse délicatement la plume à Hubert Ballay – le mieux placé puisqu’il semble avoir été le premier véritable amant -, et à son livre Dis, quand reviendras-tu ? (2014), pour effleurer les sources possibles de la chanson J’ai tué l’amour : « Ébranlée, dès sa préadolescence, par l’intimité nocturne que lui a imposée son père, Barbara a du mal, dans les années 1950, à tomber véritablement amoureuse d’un homme. Elle a pourtant tout fait pour oublier le cauchemar, elle a obligé son corps à se plier aux rites de la sensualité, donné leur chance aux émois fugaces qui, de temps à autres, lui traversaient le cœur, mais les barrières qu’elle a dressées entre elle et les hommes sont trop hautes pour autoriser une complicité amoureuse profonde, durable ». Comme si l’amour fou avec un seul homme n’était possible qu’en rêve : « Je ne sais pas vivre à deux. J’ai vécu des passions, des folies. Il faut avoir beaucoup d’espace pour vivre une passion. Dans une chambre au sixième, à deux, t’étouffes ; il faut avoir les moyens d’un amour. », confie-t-elle à Hélène Hazera avant son Châtelet 93. Et Barbara, dans son Piano noir… donne la source de cette incapacité à vivre d’amour et d’eau fraîche, après avoir évoqué la rupture avec Hubert Ballay : « Dorénavant, je suis seule (…) Rien ni, hélas !, personne, plus aucun homme, plus aucun amour. Bien sûr, des hommes et des amours. Mais c’est différent. (…) En acceptant de perdre H., je viens de prendre le voile, inexorablement, pour cette beauté : la vie d’une femme qui chante… ». Même dans Pierre, chanson de fidélité apparemment épanouie, si on l’écoute bien, « il y a deux femmes dans cette chanson », selon jacques Tournier dans son Barbara (1968). Profitons-en pour signaler un autre atout de ce Barbara Si mi la ré… : il propose un éclairage copieux sur chaque chanson de Barbara, au fil de leur apparition sur vinyle ou disque-laser !
Dès lors, se mettra en place un autre paradoxe chez Barbara, décidément femme à facettes : d’un côté il y a l’image qu’elle aime parfois donner, celle du Carpe diem et du Carpe noctem, croqueuse d’hommes, mante religieuse, égérie de l’amour libre. « Pas connaître le nom, le métier, être amants une seconde ! (…) C’est formidable. » D’où l’égérie qu’elle est pour les homos et leur goût des « tricks », du sexe avec des inconnus de passage. Dès 1987, elle chante cette chanson qu’elle aurait aimé ne jamais chanter, Sid’amour à mort, et devient amazone militante pour combattre le sida, empêcher le furet de la mort de passer en mettant à la disposition du public des corbeilles de préservatifs à la sortie de ses spectacles. D’un côté, il y a donc la femme qui répond en 1993 à Hélène Hazera lui demandant si l’amour, le sexe sont importants pour elle : « je ne peux m’imaginer chanter sans ». Et de l’autre, il y a la femme qui chante Seule en 1981 et Fatigue en 1996, un an avant sa mort. La Barbara de La solitude. Marie Chaix commente cette chanson de 1965 : « Elle avait besoin de vivre seule ? Elle n’a jamais pu vivre avec quelqu’un en permanence ». Une solitude de louve solitaire qui vous hypnotise quand elle est en scène, comme l’écrit puissamment Danièle Heymann en 1965 : « Elle est longue et noire, elle est veuve d’on ne sait trop quoi (…) Elle est médium, elle est vampire, elle viole, narines ouvertes, le jardin secret des spectateurs ».
Passionnément
Par delà le scrupule et la délicatesse, vibre tout au long de ce livre la passion de Stéphane Loisy et de Baptiste Vignol pour « la longue dame brune ». Barbara, comme Piaf, est entrée, au fil de sa vie, en scène comme en religion. Elle n’a jamais eu la plume et la partition faciles. Chez elle, paroles et musiques doivent naître en symbiose. Écrire ou interpréter des chansons viscérales comme celles de son répertoire se vit comme un chemin de lumière et de croix. Et la réputation de chanteuse rive gauche de ses débuts ne lui a jamais suffi. En 67, tournant de sa carrière, osons dire de sa vocation, elle s’ouvre enfin : « À Bobino, tout à coup, j’ai eu un public, un public populaire, c’est très important, et la jeunesse, ce qui est essentiel. J’ai été étiquetée pendant des années comme une intellectuelle, ce qui est extrêmement grave parce que je suis une primaire ».
La relation entre Barbara et son public est amoureusement réciproque. Elle en parle comme d’une étreinte violente sous le signe d’Éros : « Les gens qui ne veulent, qui ne veulent pas vous aimer, qu’il faut aller chercher dans leur cœur, autour desquels on s’enroule, c’est fantastique (…) Il y a deux moments comme ça où on est totalement… C’est une scène et avec un homme amoureux, je veux dire dans un lit. Ce sont deux moments pareils ». Sur la scène Barbara peut glisser de l’amour fugace pour un corps d’homme à ce qui va se passer de plus en plus entre elle et un public de plus en plus grand : « Je ne sais pas bien l’amour. Je sais seulement la passion ? Brûler. Il faut se brûler (…) Je crois qu’il faut se brûler, qu’il faut vivre jusqu’à la déchirure, passionnément (…) Je n’ai pas de passé, je n’ai pas d’avenir, j’ai l’instant présent ». Pas de fonctionnariat de la scène. Une vocation chaque fois nouvelle. S’en aller pour revenir ardemment au rendez-vous. Aucune musique ne lui fait peur pour entretenir la transe. Les orchestrations rock de L’aigle noir ou de François Wertheim pour l’album La Louve ne sont pas pour lui faire peur, à condition de ne jamais tomber dans la servitude du tube qu’on attend sans vraie surprise.
Et cet amour-passion, Barbara va le vivre jusqu’à la mort. Très tôt, dans sa carrière, comme Piaf et ses piqûres de morphine contre l’angoisse, il lui faut recourir à des piqûres de cortisone pour lutter contre la dysphonie. Très tôt, il faut pactiser avec les insomnies à coups de pilules et sourire de la différence entre une tentative de suicide et un véritable suicide. « La renifleuse des amours » est priée de repasser et le fil du micro la rattache toujours au monde. François Reichenbach enregistre un spectacle et n’hésite pas à écrire : « Barbara, c’est toute la beauté et l’angoisse de notre époque, la définition même du stress ». Sa voix devient rauque et elle fait avec. Ce rauque devient de plus en plus fascinant d’album en album comme la voix de Marianne Faithful. Les rationalistes en sont éblouis, comme Michel Cressole en 1981 : « C’est la méthode du mal par le mal, une recette naturelle d’antipsychiatrie populaire que les usagers de Barbara se transmettent de génération en génération ». Baptiste Vignol, de page en page, en vient à un vrai lyrisme inspiré : « Enveloppée de châles, lunettes sur le nez, elle hurle son texte, dans une tension paroxystique pour déclarer sa flamme au public ». Barbara fait don au public de tout ce que la vie lui a appris : « Ce qu’ils ne savent pas, c’est que c’est moi qui suis spectatrice de ce public à mille bras, avec un cœur géant (…) Si je n’avais pas connu la tranche de jambon pout tout déjeuner, je ne pourrais pas entre en scène ». Gérard Daguerre, son pianiste, lors des dernières soirées du Châtelet en décembre 93, parle d’elle comme on parlait de Piaf juste avant sa mort : « J’avais le sentiment qu’elle se suicidait tous les soirs ». Dernier album trois ans après et puis, l’année suivante, en novembre qu’elle aimait, s’éteindre dans sa maison de Précy lorsque Il automne tout autour d’elle.
Merci à ce beau millefeuille, inépuisable de textes et de photos superbes, de nous laisser, quand on le referme, plus émus à chaque fois que monte
Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous
Pierre LACROIX, co-éditeur d’EO